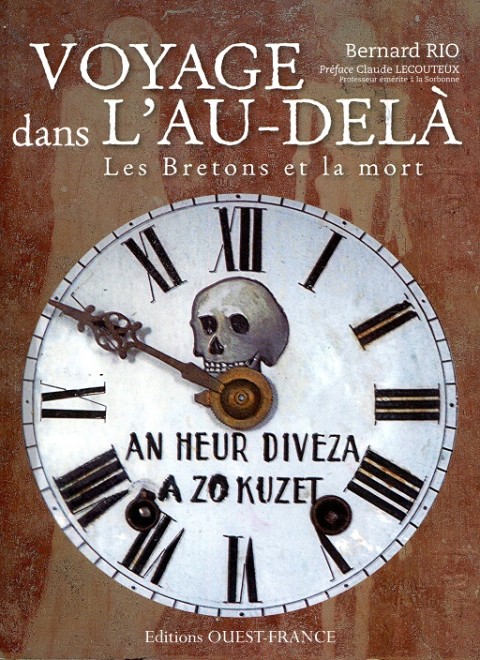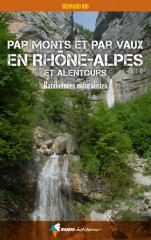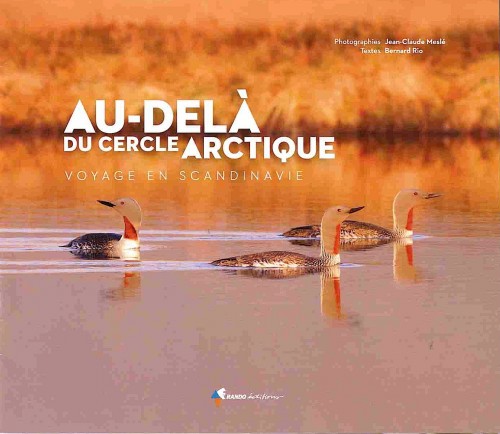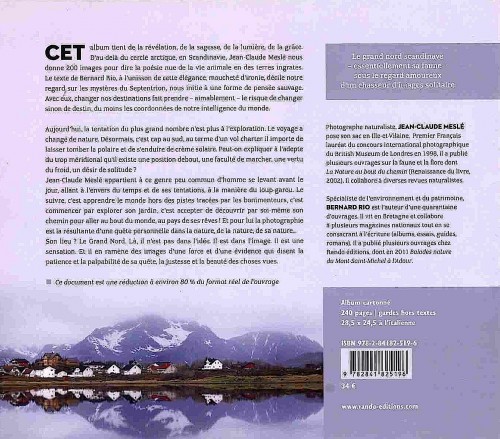Le cul bénit : amour sacré et passions profanes
Bernard Rio, préface Michel Maffesoli, édition Coop Breizh
Parution le 7 décembre 2013 et présentation à la librairie Coop Breizh, rue Elie Fréron à Quiimper (29)
Préface de Michel Maffesoli
Des penseurs comme Nietzsche ont rendu attentif à cette « magie des extrêmes ». Manière, pour lui, de renverser les barrières établies par la bêtise philistine. Mais également force agissante d’une sagesse humaine fondée sur l’acceptation de ce qui était considéré comme le Mal. L’intérêt du livre de Bernard Rio est de montrer que , sur la longue durée, et fortement enracinée dans la vie quotidienne, ce que le moralisme "bien-pensant" nomme excès est au fondement même de tout vivre-ensemble. Telle est bien l’essentielle "leçon" que nous donne LE CUL BÉNIT !
G. Bataille , dans toute son œuvre, a montré la puissance de «la « dépense » dans la constitution de l’homme souverain. Cet « homme du surcroît » qui ne s’accommode pas des petitesses comptables. Sans oublier G. Deleuze : « nous nous servons de l’excédent pour inventer de nouvelles formes de vie ». Même si cela n’est pas conscientisé ou verbalisé en tant que tel, c’est bien ce souci d’un qualitatif qui semble prévaloir dans la vie de tous les jours. Créer sa vie, créer dans sa vie. Jouir au présent de ce qui est donné à vivre. Voilà bien la sensibilité à l’œuvre dans l’élaboration de ces « lois » particulières, officieuses, souterraines mais dont l’efficace est, de plus en plus, évident.C’est bien ce que résume l’auteur lorsqu’il declare : “ l’amour charnel peut aussi s’avérer sprirituel”
J’ai parlé, pour ma part, d’une « éthique de l’esthétique » comme un écho diffus au panache du Cyrano d' E. Rostand : « c’est bien plus beau lorsque c’est inutile ». Inutilité ambiante. Voilà bien quel pourrait être le modus operandi d’un monde que l’on n’entend plus dominer, mais dont on veut, tant bien que mal, jouir. Avec érudition et humour, B.Rio nous fait “déambuler dans les champ mégalithiques ou les chapelles” à la recherche de cette nécessaire inutilité ciment ( ethos) de tout socialité
Ainsi que le remarquait le sage Montaigne : « les hommes aux faits qu’on leur propose s’amusent plus volontiers à en chercher la raison qu’à en chercher la vérité. Ils laissent là les choses et s’amusent à en traiter les causes » (III, 13). Avec une gradation judicieuse : "Préhistoire amoureuse", "Les Sirènes de l’amour", "Un culte pas catholique", "Le langage du corps", ce livre nous permet de rester aux choses mêmes. En ne les maltraitant pas, ne les surplombant pas, il souligne le désengagement radical vis-à-vis de l’utilitarisme du moralisme marchand.Ce qui est nommé une "juxtaposition des symboles" montre bien cette intemporelle “quête du Graal” suscité par la nostalgie de ce que je nomme "ordo amoris".
Par ce que B.Rio nomme "Le beau Dieu", on entre dans une "connaissance progressive" de la déité. Ainsi l’homme peut comprendre l’ordre divin, "le contempler et contribuer à l’harmonie universelle". Ce qui renvoie à un être englobant : celui de la raison et du sensible. En d’autres termes autant la recherche de l’au-delà, d’une essence des choses a pu être le fondement d’une vision morale du monde, autant l’éthique mettra l’accent sur l’existence en ce qu’elle a d’impulsif, d’instinctuel, de pré-conscient, en bref de jouissance animale. Forme primaire ! Elan vital
Le lecteur suivra, avec délice existentiel et intérêt de connaissance, la déambulation que propose B.Rio au travers de ces lieux saints dont il connaît la vraie signification: celle du symbole constitutive d’un éternel inconscient collectif . Ainsi l’on entrera , progressivement, dans une conception cosmogonique qu’exprime le lieu saint qui est, comme le dit bellement l’auteur « le milieu du monde… centre de communication entre le plan terrestre et le plan céleste ». Organicité du matériel et du spirituel, du bien et du mal, en un centre de l’union enrichi des contraires.
Michel Maffesoli
Professeur à la Sorbonne
Institut universitaire de France
Administrateur du CNRS
Sommaire
Préface Michel Maffesoli
Introduction
I Préhistoire amoureuse
La grande Déesse
Le bon Dieu
Fuseau et quenouille
De chair et de pierre
Vénus au bain
Cupidon, Éros et Guernichon
II Les sirènes de l’amour
Femmes à la fontaine
Aux sources de l’amour
Le pied du saint et la fille épinglée
La fée et la sirène
L’être et le paraître
Le peigne et le miroir
Belle de mer
Centaure lubrique
III Un culte pas catholique
Scheela
Mauvaise fille et Notre-Dame
Sein et sainte
Les trois seins de Gwenn
Cul nu
IV Le langage du corps
Le sexe des anges
Baiser et embrasser
Le péché de chair
Le chant des grenouilles
L’évangile des quenouilles
Le principe du mâle
Le chien, l’androgyne et le satyre
Le règne du petangueule, du chieur et du lèche-cul
Un monde de fous
Les danseurs endiablés
Conclusion
Lexique/Glossaire
Index géographique
Index des noms propres
Index thématique
Bibliographie
Introduction Bernard Rio
Le cul-bénit associe la partie cachée du corps et l’esprit bien pensant. Cet oxymore qui acoquine la chose dont il ne faudrait pas parler et la morale qu’il faudrait suivre, joue avec les mots et les concepts, en juxtaposant le derrière de l’homme et la vitrine de la religion, l’image de l’un et l’imagination de l’autre permutant aisément !
Le cul-bénit : ces deux mots qui désignent à l’origine le paroissien si confit de dévotion qu’il en oublierait l’œuvre de chair, ce bon mot et ce gros mot qui ne vont prétendument pas ensemble, ce mot qui place les idées sous la ceinture et cet autre qui élève l’esprit, cette expression improbable, tout cela se révèle finalement pertinent pour évoquer ce que chacun peut voir ou ne veut pas voir, ce qui est caché et ignoré dans la nature et dans l’architecture, dans le cœur de l’homme et dans l’âme du monde, dans le microcosme et le macrocosme.
En visitant les sanctuaires bretons, je sentais confusément qu’il existait une cohérence entre le lieu et l’esprit du lieu, entre la forme et la fonction. Je pressentais que l’image licencieuse ne se réduisait pas à une vulgaire exhibition. J’en ai cherché la clé dans les livres et les bibliothèques, accumulant les traités d’art sacré et effeuillant les ouvrages érotiques, ouvrant les portes des chapelles et papillonnant sur les blogs coquins. La quête fut souvent vaine, tant dans les discours orthodoxes des docteurs de l’art chrétien que dans les propos superficiels des jouisseurs. La porte s’entrouvrit une première fois en lisant la topographie légendaire de Claude Gaignebet et de Jean-Dominique Lajoux, en particulier leurs interprétations symboliques de la chapelle de Berzé-la-Ville (71) et de l’église de Commensacq (40). L’ethnologue et mythologue Claude Gaignebet redonnait du sens en raccordant l’architecture, le paysage, le calendrier, l’étymologie, le folklore et la mythologie. Il dépassait en les amplifiant les travaux d’Arnold van Gennep et Henri Dontenville. « Un site constitue, selon nous, une sorte de réseau qui, à partir des toponymes, relie les vestiges archéologiques, les fêtes calendaires, les monuments et les œuvres d’art sacré. Dans la plupart des cas, le travail de reconstitution d’un paysage mythique cohérent est aléatoire et les chaînons manquent » (Claude Gaignebet et Jean-Dominique Lajoux, « Art profane et religion populaire au Moyen-Âge » Presses universitaires de France, 1985). En parcourant le réseau de la Bretagne sacrée, je me suis à mon tour évertué à relier les lieux et les rites. Mes yeux se décillaient, toutefois la matière qui s’offrait à mon regard demeurait hermétique, complexe, voire contradictoire et incompréhensible.
C’est hors d’Europe et hors du champ moderne que j’eus le déclic. Je dois à Alain Daniélou de m’avoir ouvert la porte invisible. Claude Gaignebet m’avait apporté une hauteur et une amplitude de vue qui me permettaient d’englober un site, Alain Daniélou m’offrait la pratique religieuse. C’est en lisant les premières lignes de l’ouvrage qu’il consacra en 1977 au temple hindou, que je compris la nécessité de changer mon regard sur le sanctuaire breton et son décor pour les appréhender et les apprécier pour ce qu’ils devaient être. « Le temple hindou n’est pas un lieu de réunion où s’assemblent les fidèles. C’est, dans un endroit choisi pour des raisons magiques, un édifice construit dans le but de capter des influences subtiles. C’est un centre magnétique grâce auquel des prêtres, magiciens qualifiés, vont pouvoir au moyen de rites évoquer la présence réelle d’une divinité. C’est donc un centre de communication entre deux mondes qui se côtoient et s’entremêlent et pourtant s’ignorent, un peu comme un récepteur de radio permet de capter et de révéler des ondes partout présentes mais non perçues », écrit Alain Daniélou (Alain Daniélou, « Le-Temple-Hindou » éditions Buchet-Chastel, 1977). Certes le clergé séculier breton n’est plus depuis belle lurette composé de magiciens qualifiés, mais constitué d’animateurs sociaux plus ou moins motivés et moins que plus cultivés. À défaut des prêtres épris de spiritualité, il subsiste les lieux dont chacun peut chercher le sens. Chacun voit selon son degré de conscience.
Le point de vue d’Alain Daniélou induit que le sanctuaire est une continuité du monde divin et qu’il existe « une interdépendance absolue entre ces divers aspects de ce que nous appelons l’existence, la réalité ». Partant de ce principe, j’ai adapté au sanctuaire breton les règles du temple hindou en revoyant les formes, les orientations, les dimensions, les dédicaces, le calendrier et les rites qui font de ces lieux des centres d’énergie. La présence d’une sculpture sur un chapiteau roman ou sur une sablière de la Renaissance opère dès lors que l’homme déambule dans le bon sens et élève son esprit en corollaire à son regard. A contrario, regarder sans conscience et à contresens un personnage ithyphallique ou une « sheela na gig » peut induire un basculement, une inversion, une aversion ou un envoûtement.
Supposer que le phallus ou la vulve exposés au vu et au su de tous est un divertissement d’artisan ou une représentation du péché, c’est méconnaître la structure du sanctuaire et la pensée traditionnelle.
Le décor n’est pas anodin. De même que les astres influent sur le règne végétal et le règne minéral, il existerait des relations subtiles entre les règnes animal, végétal et humain. Au temple et à son décor correspondraient l’homme, ses organes et ses humeurs. Le sanctuaire breton posséderait l’équivalent des chakras hindous, des seuils pour sentir et percevoir une autre dimension.
Résultat de longues années d’errance et de tâtonnement, puis de réflexion sur le sexe et la religion, cette étude induit des retrouvailles. L’erreur serait en effet de séparer le profane et le sacré, de disqualifier l’un pour célébrer l’autre car le sujet n’est pas frivole et l’exhibition d’un cul n’aiguise pas seulement les sens physiques. L’amour charnel peut aussi s’avérer spirituel ! La voie de Dieu peut aussi emprunter le chemin des Dames. Aux grenouilles de bénitier font écho les vêpres des grenouilles.
Ce n’est point avec des préjugés qu’il convient de déambuler dans les champs mégalithiques ou les chapelles, car l’apparence est souvent un voile qu’il faut soulever pour apercevoir, apprendre et comprendre le sens de la déesse du soir et du démon de midi. La quenouille du diable et le fuseau de la Vierge sont indissociables sur le rouet cosmique.
Les bâtisseurs du Moyen Âge et les sculpteurs de la Renaissance ont légué un puzzle de scènes dans l’ombre de la voûte et dans la lumière du chœur, scènes dont on ne peut comprendre le sens si on ne cherche pas à interpréter l’ensemble du décor et si on sépare le motif du lieu. L’analyse symbolique est complexe. En 1908, dans son monumental ouvrage « L’art religieux de la fin du Moyen Âge en France », Émile Mâle (1862-1954) soulignait : « Au XVe siècle comme au XIIIe siècle, il n’est pas une œuvre artistique qui ne s’explique par un livre. Les artistes n’inventent rien ; ils traduisent dans leur langue les idées des autres. Pour expliquer une œuvre d’art du XVe siècle, les fines remarques de l’amateur, ses vues les plus ingénieuses ne sauraient suffire. Il ne sert à rien d’essayer de deviner, il faut savoir. Il faut trouver le livre que l’artiste a eu sous les yeux, ou, tout au moins, si l’on ne peut nommer un livre, il faut faire comprendre de quel grand travail de la pensée religieuse son œuvre est sortie. La lecture des théologiens, des mystiques, des hagiographes, des sermonnaires, du XIVe au XVIe siècle était donc une des parties essentielles de notre tâche. Cette méthode quand il s’agit de l’art du moyen âge, est la seule qui puisse être féconde : on atteint ainsi jusqu’aux sources profondes de la vie morale du temps ». L’historien de l’art avait raison mais il convenait d’y associer la mythologie et le folklore, puis d’apprendre la langue d’Hermès, ce qui suppose d’identifier le symbole et de l’articuler avec un ensemble. Le langage des bâtisseurs n’est ni désinvolte ni inintelligible. Il se réfère à une culture structurée et est un enseignement. Isoler une scène pour justifier une théorie, ce serait tronquer et trahir un schéma cohérent. L’historien de l’art ne peut faire abstraction de l’archéologie et de la mythologie dont les traces se prolongent dans les croyances populaires et le folklore. Isoler un élément, ce serait aussi négliger la comparaison et réduire le sujet à une catégorie, ainsi la représentation dans le porche sud de la chapelle Notre-Dame-du-Tertre à Chatelaudren (22) ne serait aux dires de certains qu’une personnification de la luxure ! Or, cette acrobate n’ouvre son sexe qu’au regard des seuls ignorants si envoûtés par le spectacle qu’ils en oublient de regarder autour, de suivre la chasse sculptée du porche qui métamorphose cette proie en une initiatrice matricielle tandis que les fresques intérieures offrent la perspective d’une divinité virginale associée à sainte Marguerite !
L’originalité de la Bretagne est de posséder une amplitude historique et une multitude de sources. Il serait d’ailleurs plus judicieux d’évoquer une évolution des techniques et des formes depuis l’antiquité voire depuis la préhistoire qu’un changement structurel tant la symbolique s’inscrit dans un temps mythique. L’art d’aimer se décline à la fois dans les tracés du néolithique, dans la sculpture romane du XIIe siècle, sur les sablières du XVIe siècle, dans la légende grivoise et dans la chanson courtoise. Cet art dans les chapelles est hors du temps. Il ne relève pas uniquement d’une époque où les bâtisseurs illustraient davantage la connaissance que le savoir. Cet art est aussi étranger au dogme. Il n’appartient pas aux docteurs de la foi. Cet art est une manifestation sacrée, l’écho d’une civilisation où se conjuguent l’élan terrestre de la grande déesse honorée par le peuple des mégalithes et la flamme céleste des pasteurs indo-européens.
La juxtaposition des symboles est en réalité une superposition et une conjugaison qui s’inscrivent dans une durée. Aux mélanges primitifs, succède le roman d’amour du XIIe siècle. La littérature courtoise et la pensée mystique puisent leur inspiration dans les sources de la mythologique celtique. La quête aventureuse du Graal bouleverse alors les codes chrétiens, pénètre dans les livres de pierre et les parchemins. La culture du moyen âge est janusienne, ce que Marie-Madeleine Davy a mis en évidence dans « Initiation à la symbolique romane » en 1977, l’année même où Alain Daniélou publiait « le temple hindou ». « L’amour de Dieu se suffit ; l’amour charnel peut se suffire. ce dernier n’est point d’ailleurs privé de signification : il s’exprime dans un ordre de beauté et de poésie. Défions-nous des esprits dévots qui risquent toujours de discerner des grimaces dans ce qui leur échappe ». (Marie-Madeleine Davy, « Initiation à la symbolique romane », éditions Flammarion 1 977)
Il n’y a pas au Moyen Âge une opposition absolue entre le sacré et le profane. La séparation qui va apparaître et s’accentuer au cours des siècles ultérieurs pour culminer à partir du XVIIIe siècle introduit l’idée d’une dualité entre la chair et l’esprit. De cette distinction naquit une confusion intellectuelle et spirituelle où la honte, la violence et la dévotion prévalurent sur la beauté, l’équilibre et la connaissance.
En modifiant sa façon de pensée et sa manière de se comporter, l’homme a refermé la porte du temple intérieur. Il a nié la chair ou déifié l’esprit et vice-versa, se réfugiant dans les extrêmes de la concupiscence et de la mortification, de la pulsion et de la raison. Le paradoxe du cul-bénit, qui dévoie le profane et le sacré, était né. C’est donc à un va-et-vient entre la préhistoire et les temps modernes, à des retrouvailles et des épousailles que cet ouvrage invite le lecteur et le promeneur, retrouvailles avec la chair et avec l’esprit, pour réapprendre l’amour dans les chapelles et dans les corps, pour bénir le cul et pour affranchir l’âme de l’esprit pompeux.